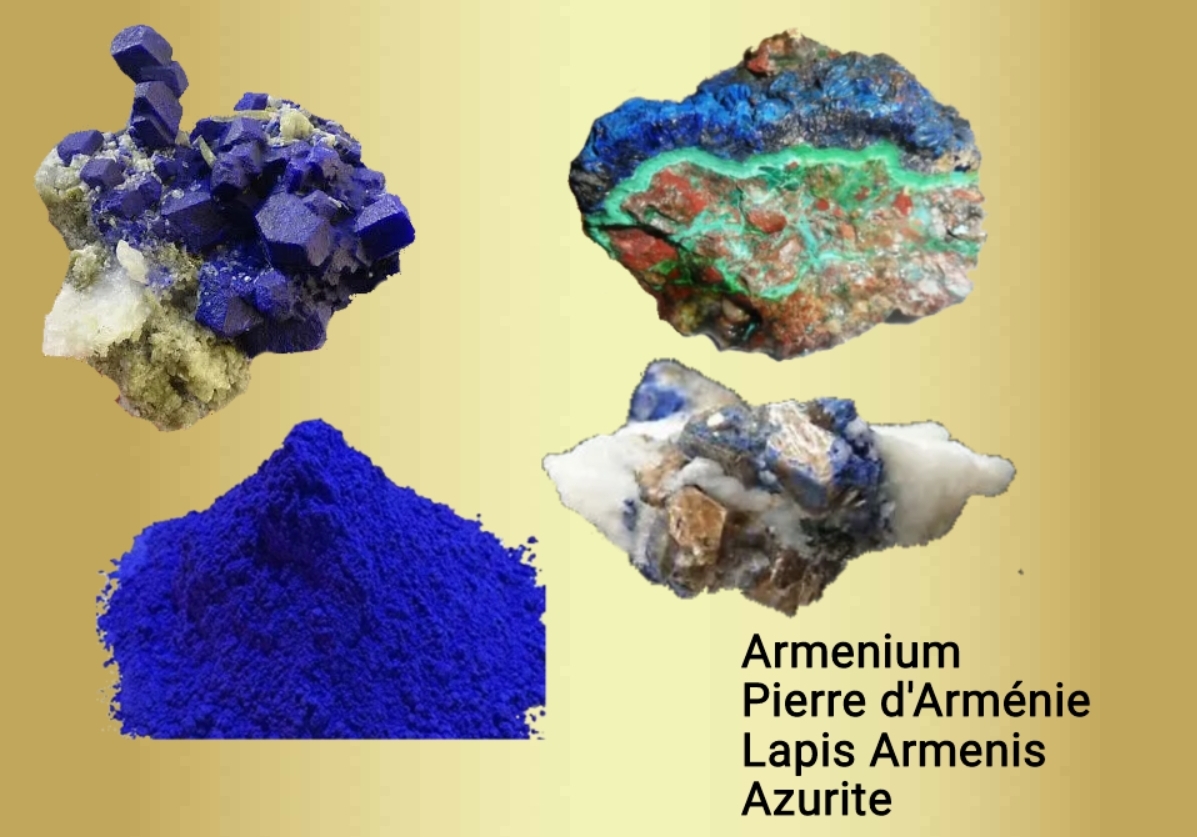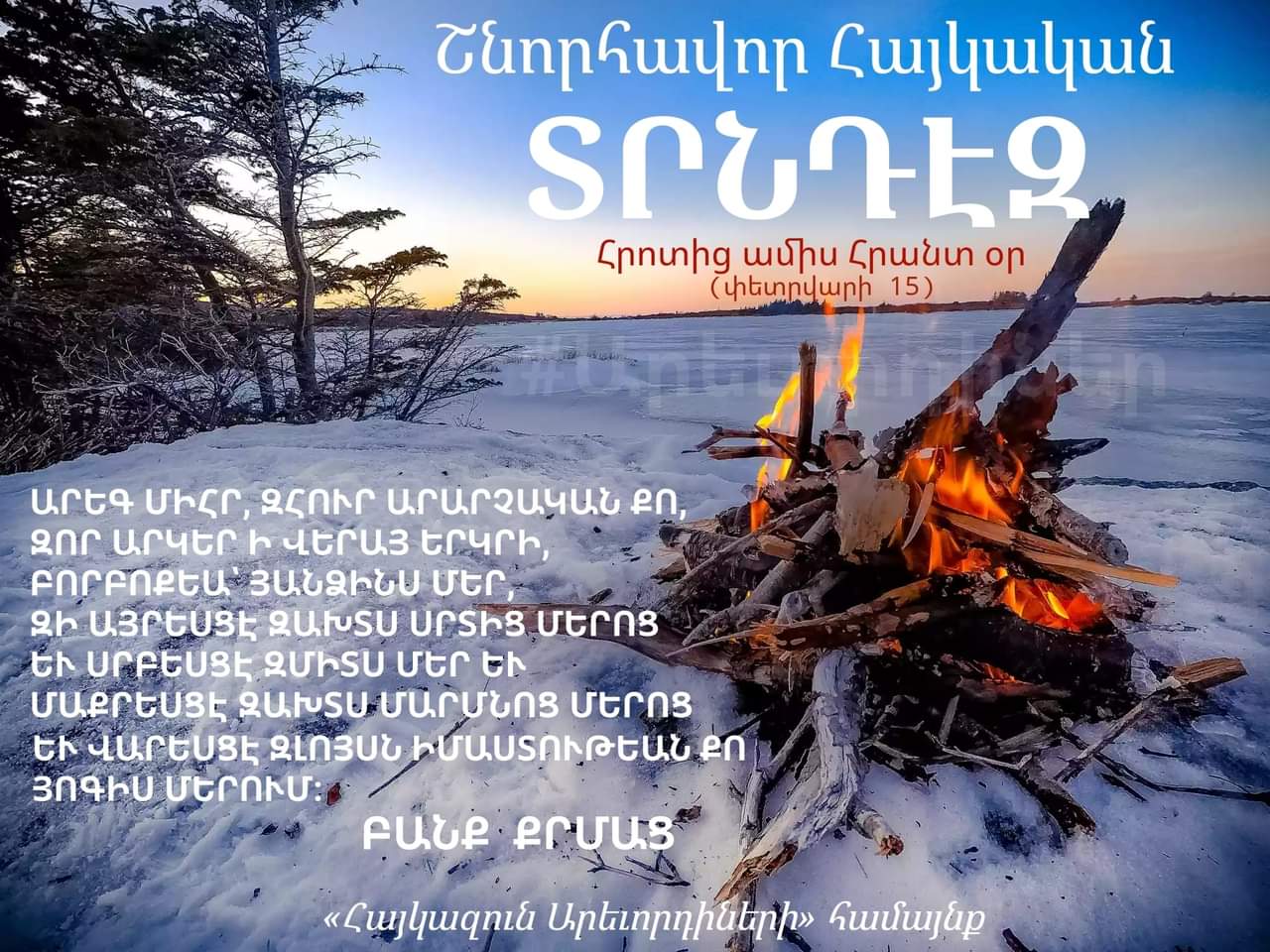«Offrande» — hommage, don ; «offrir» — présenter un hommage.
«Être celui qui porte l’offrande des autels» — c’est ce que mentionne le dictionnaire Nouveau Dictionnaire de la Langue Haïkazienne, lorsqu’il parle des vers épiques créés par les Ancêtres. On y lit aussi :
«Offrande» — action d’apporter et de présenter des offrandes ; dons et objets sacrés.
«Porteur d’offrande» — celui qui porte des offrandes, celui qui fait des dons, chargé d’offrandes.
«Nous avons traversé les remparts porteurs d’offrandes pour Darius» (Khorenatsi, B, 45).
Depuis des temps immémoriaux, dans différents peuples, la coutume des offrandes, connue sous le nom de « Rite de la générosité », a des origines naturelles. L’éminent ethnographe Yervand Lalayan, dans son article Les Rites cérémoniels chez les Arméniens, met en lumière la formation et le développement du rituel symbolique des offrandes, où « L’offrande volontaire devient peu à peu une obligation ».
« …L’agriculteur arménien n’allait jamais rencontrer un notable sans apporter une offrande. Même le mot « rencontrer » a pris le sens de « donner une offrande ». Cette même coutume se retrouve également parmi d’autres peuples », écrit-il dans son article Les Rites cérémoniels chez les Arméniens selon H. Spencer, en rappelant certains exemples.
« Sous la domination des princes arméniens, les commerçants ne faisaient qu’offrir des présents au prince et n’étaient pas soumis à un impôt spécifique. Aujourd’hui, cette même coutume existe parmi les beys kurdes et turcs…
Chaque année, lors de certaines fêtes, même les généraux indiens, qui n’étaient pas tenus de payer des taxes, faisaient des offrandes à leur souverain, en signe de soumission. »
En évoquant l’habitude de faire des offrandes par des individus ou des communautés, et leur signification, il dessine le chemin par lequel l’offrande volontaire se transforme peu à peu en « tribut obligatoire », puis, avec l’apparition de la monnaie, devient un impôt.
Poursuivant le thème de la publication précédente, nous examinons quelques autres extraits tirés de l’étude susmentionnée de Yervand Lalayan, publiée en 1912 dans le 23e volume de la revue Ethnographic Journal, à Tiflis.
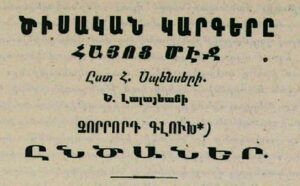
Dons rituels
« Les voyageurs, dans leurs relations avec des peuples étrangers, ont pour coutume d’essayer de gagner leur faveur en offrant des dons rituels.
Cette pratique produit deux effets : d’une part, le plaisir procuré par la valeur de l’objet offert crée une disposition amicale chez l’étranger ; d’autre part, le geste d’offrande exprime silencieusement le désir du donateur de plaire, ce qui le rend également plus agréable aux yeux de l’étranger.
C’est dans ce désir que réside l’origine de l’offrande en tant que rite.
Le lien entre le sacrifice corporel et l’offrande, c’est-à-dire le don d’une partie du corps ou d’un objet, est clairement illustré dans un récit de Garcilaso, où il est montré que l’offrande devient un moyen de réconciliation, quel que soit la valeur de l’objet offert.
Garcilaso, en décrivant la vie des porteurs, explique que, lorsqu’ils atteignent le sommet d’une montagne, ils déposent leurs fardeaux et disent à leur dieu Pachacamac : « Merci de m’avoir permis de porter ces charges jusqu’ici. »
Ensuite, comme offrande, ils arrachent un cheveu de leurs sourcils ou retirent de leur bouche une herbe appelée kuka, considérée comme l’un de leurs biens les plus précieux. S’ils n’ont rien de plus à offrir, ils présentent un brin de paille, un caillou ou un morceau de terre durcie.
On trouve souvent de grands tas composés de ces offrandes au sommet des cols montagneux. »

Le même phénomène se retrouve également parmi les Arméniens.
Par exemple, lorsqu’ils passent près de sanctuaires situés sur les routes ou dans des lieux inhabités, et qu’ils n’ont pas la possibilité d’offrir de l’encens ou des bougies, les voyageurs jettent une pierre sur le sanctuaire, considérant ainsi avoir accompli leur devoir d’offrande.
Bien que l’idée de sacrifier des parties du corps, des objets précieux ou des objets de peu de valeur puisse nous sembler étrange à première vue, leur étrangeté est atténuée lorsque l’on se souvient qu’en France, on peut souvent voir des tas de petites croix en bois sur les socles des croix de pierre le long des routes.
La valeur de ces croix ne surpasse pas celle des brins de paille, des bâtons ou des pierres offerts par les Péruviens, et, comme les offrandes mentionnées plus haut, elles révèlent cette vérité : l’offrande devient un rituel exprimant le désir d’obtenir une faveur, une forme de pitié divine.
Une tradition arménienne raconte qu’un jour, deux chameaux broutaient ensemble et, après s’être rassasiés, l’un d’eux cueillit une épine et la plaça dans la bouche de l’autre.
L’autre chameau lui demanda : « Pourquoi fais-tu cela ? Ce n’est qu’une épine, la même que celle que nous avons mangée et qui nous a rassasiés. » Et le premier chameau répondit : « Une épine reste une épine, mais le geste (c’est-à-dire l’acte de respect) est doux. »

« Avec le renforcement du pouvoir politique, les offrandes généreuses, d’abord volontaires et individuelles, sont peu à peu devenues moins volontaires et plus généralisées, ouvrant la voie à l’instauration de sanctions obligatoires sous forme de tribut. Puis, avec l’apparition de la monnaie, ce tribut s’est transformé en impôt. »

« La manière dont ce changement se réalise est clairement visible dans les coutumes persanes.
Malcolm, lorsqu’il parle des taxes irrégulières et excessives auxquelles les Perses sont continuellement soumis, observe : « Ces taxes, qu’elles soient initiales ou supplémentaires, sont appelées ‘offrandes ordinaires et extraordinaires’.
Les offrandes ordinaires, présentées au roi, sont celles qui, chaque année, sont données par les gouverneurs des provinces et des districts, les chefs militaires, les ministres et autres hauts fonctionnaires lors des festivités du Nouvel An de Nowruz. » »

« La quantité de ces offrandes est généralement déterminée par la coutume. Celui qui en apporte moins que ce qui est fixé risque de perdre sa position, tandis que celui qui en apporte davantage obtiendra une plus grande faveur du roi. »

« Ce qui a été dit à propos de l’Orient dans son ensemble peut également être appliqué plus spécifiquement à l’Arménie, qui en fait partie.
Les serviteurs des princes arméniens, leurs soldats et commandants n’ont jamais perçu de salaire régulier, mais se sont enrichis grâce aux récompenses offertes par le prince, appelées « khalat », ainsi qu’aux cadeaux offerts par le peuple.
Même aujourd’hui, dans de nombreuses régions, les chefs de village, les juges et les percepteurs ne reçoivent pas de rémunération fixe, mais vivent des présents donnés par les villageois, qui sont progressivement devenus des pratiques obligatoires.
Par exemple, au Nouvel An, chaque maison offre au chef de village une bouteille de vodka et une paire de chaussures, et à Pâques, un agneau et des œufs.
Chaque couple marié lui offre une paire de chaussures ou de bottes et 1 ou 2 roubles. De plus, les villageois fauchent gratuitement ses champs en fournissant un ouvrier par maison.
Comme il existe la croyance que le double du défunt, qui lui ressemble en tout, est soumis à des souffrances telles que la faim, la soif, le froid et la douleur, il en découle que le défunt a également besoin de nourriture, de boisson, de vêtements, etc.
Ainsi, les offrandes faites aux défunts ne diffèrent pas, ni par leurs motivations ni par leur signification, de celles offertes aux vivants.
On peut observer cela dans toutes les sociétés du monde.
Les Papous, les anciens Péruviens, les Brésiliens, et d’autres placent de la nourriture et des boissons près des corps avant l’inhumation.
Le même phénomène est observé parmi les Arméniens de Géorgie : tant que le défunt est dans la maison, sa part de nourriture et de boisson est placée à côté de son cercueil lors des repas, puis après un moment, elle est donnée aux pauvres ou à une personne de la même taille que le défunt pour qu’elle la consomme.
Certains placent même des bouteilles de vin dans le cercueil des défunts amateurs de vin, et des fruits dans celui des enfants.
À Bulanakh, les Arméniens envoient chaque jour, pendant un an, une portion de nourriture de la maison du défunt à une maison pauvre, en guise de « part de l’âme » du défunt.
À Vaspourakan, jusqu’au septième ou quarantième jour après le décès, le prêtre, les chantres et quelques pauvres sont invités chaque jour à la maison du défunt pour prendre un repas.
À Van, au lieu d’inviter ces personnes chez eux, les familles envoient le repas à l’église pour qu’ils le partagent.
Ces repas sont appelés « part de l’âme » ou « repas de l’âme ». Le jour de l’enterrement, au septième jour, au quarantième jour et à l’anniversaire de la mort, un grand festin est offert à de nombreuses personnes.
Dans plusieurs régions (en Afrique, en Amérique, dans l’ancien Orient…), de la nourriture et des boissons sont déposées sur la tombe après l’enterrement. »

Dans presque toutes les régions d’Arménie, lors des jours de commémoration des morts, on apporte de la nourriture, des boissons et des fruits au cimetière, et après avoir béni les tombes, les gens mangent et boivent, en versant d’abord un peu de boisson sur la tombe, puis laissent les restes sur celle-ci.
À Vaspourakan, le Vendredi Saint et le jour de la commémoration des morts à Pâques, ils préparent du pain et le distribuent aux pauvres. Dans certaines régions, comme au Karabagh et à Aparan, lors des jours de commémoration du Vendredi Saint, de Pâques ou de l’Assomption de la Vierge, chaque famille apporte des plats au cimetière ou à l’église, où ils partagent un repas ensemble et célèbrent une messe pour tous les défunts. Les restes sont soit déposés sur les tombes, soit partagés avec les pauvres.
Les habitants de Karin (Erzurum), ainsi que les réfugiés de Karin à Alexandropol (Gyumri), Akhalkalak et Akhaltsikh suivent la coutume suivante : lors de la fête de la Sainte Croix, les proches du défunt envoient un agneau, un châle noir et un tapis noir à la maison des esprits. L’agneau est utilisé pour préparer un plat appelé « keashkek » qui est ensuite amené au cimetière. Là, ils bénissent la tombe du défunt et mangent le repas avec leurs proches près de la tombe. Ce qui reste est déposé sur la tombe. (Pour préparer le keashkek : on fait cuire du blé, qu’on égoutte et met dans un four, puis on suspend un agneau écorché au-dessus, de sorte que la graisse de l’agneau tombe sur le blé. Une fois l’agneau rôti, on le découpe et on le mélange avec le blé, en y ajoutant des oignons frits).
En comparant les coutumes de différents peuples, Y. Lalayan écrit :
« Il n’est pas difficile de conclure que l’offrande faite au défunt a la même signification que celle faite à une personne vivante, la seule différence étant que celui qui reçoit l’offrande est invisible.
Il est également évident que la motivation pour obtenir la bienveillance des êtres surnaturels, avec lesquels l’homme primitif croyait être entouré, est la même. »

« De nombreux peuples à travers le monde avaient pour coutume, avant de manger, de verser une petite quantité de leur nourriture et de leur boisson en offrande aux esprits.
Voyons maintenant comment ce rituel s’est développé parallèlement au culte des êtres surnaturels.
Les objets offerts et les motivations des offrandes sont restés les mêmes que dans les exemples précédemment mentionnés, bien que cette similitude soit quelque peu voilée par l’usage des termes « sacrifice » pour les dieux et « offrande » pour les vivants.
Cette origine commune se reflète clairement dans le proverbe grec suivant : « Les offrandes guident les actions des dieux et des hommes ». »

« La nourriture et les boissons, qui formaient les premières sortes d’offrandes généreuses présentées aussi bien aux vivants qu’aux esprits, représentent également une partie essentielle des sacrifices adressés aux dieux.
Dans les régions où le pouvoir commence à émerger, les offrandes faites aux chefs militaires se composent principalement de nourriture. Là où le culte des Ancêtres évolue, et où ce culte transforme les esprits en divinités, les sacrifices se composent, pour l’essentiel et en tout temps, de nourriture et de boisson.
Il est indéniable que cela est vrai pour les classes sociales inférieures, ce qui ne nécessite aucune preuve. Concernant les classes supérieures, c’est également un fait largement reconnu, même si parfois contesté. »